Mazarin MFUAMBA Katende, de son nom complet Mazarin Pierre Mfuamba Katende, est né le 27 avril 1959 à Kabue. Il a effectué ses études secondaires au Petit Séminaire de Kabue et ses études supérieures à l’Université de Lubumbashi, avant de suivre une formation doctorale à l’Université Libre de Bruxelles. Il a occupé le poste de maire de la ville de Kananga et est également Professeur Associé à l’Institut Supérieur Pédagogique de Kananga. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont « Justice Politique et Démocratie chez J. RAWLS » et « Repères pour une rationalité politique africaine contemporaine ».

Il fut parmi les orateurs de la journée scientifique qui avait pour thème central » Rôle des hommes de lettres dans la résolution des conflits de l’Est de la R.D.C. » organisée par la faculté de Lettres et Sciences humaines de l’Université Pédagogique de Kananga (U.P.KAN), en date du 02 août 2025.
En effet , nous vous proposons le texte intégral qui a fait l’objet de son exposé basé sur le sous-thème
» Justice politique et bien-vivre-ensemble. Exigence d’une allocation universelle des ressources dans les pays des grands lacs africains «
0. INTRODUCTION
A ce jour, la vie des pays des grands lacs en Afrique de l’est ressemble à un état de guerre perpétuelle. Les nations s’élèvent les unes contre les autres pour se conserver, vivre ou survivre ou encore s’affirmer. Chacun a comme un droit légitime d’utiliser tous les moyens à sa disposition pour se faire entendre : la force des armes, le mensonge ou la ruse. Et l’Est de la République Démocratique du Congo qui avoisine directement les grands lacs s’est transformé en une poudrière, l’épicentre de la barbarie.
En effet, depuis près de 30 ans, dans la région de pays des grands lacs on se bat. On se trouve comme enlisés dans une situation de conflit permanent qui a déjà causé des milliers de morts, des massacres, des génocides, des viols, des pillages, des milliers des déplacés internes, des milliers de réfugiés et des populations vivant dans une totale incertitude sous la violence et la terreur. Les citoyens des Etats des grands lacs ne sont-ils pas devenus des loups les uns pour les autres ? A quelles conditions l’Afrique des pays des grands lacs pourrait-elle devenir un jour un lieu du bien-vivre-ensemble à la fois comme citoyens et comme peuples ?
Ces questions ont constitué pour nous une interpellation et sont à l’origine de la réflexion qui a conduit à la conception de cet article intitulé : « Justice politique et bien-vivre-ensemble. Exigence d’une allocation universelle des ressources dans les pays des grands lacs africains ». Il suggère d’une part qu’une application des principes de justice politique « justes » est une condition sine qua non du bien-vivre ensemble entre les citoyens de chaque pays d’une part et entre tous les peuples de tous les Etats de l’Afrique des grands lacs d’autre part. Quel pourrait être alors le contenu de tels principes ? Cette communication suggère d’autre part qu’une allocation universelle et non naturelle des ressources pourrait-être un des leviers majeurs d’une justice politique « juste » et d’une paix durable. En quoi pourrait consister une telle allocation ?
Pour répondre à toutes ces questions, cette communication se divise en trois parties. La première partie est intitulée : « définition des concepts ». Elle poursuit comme objectif de fixer les idées et de jeter un éclairage sur les expressions les plus importantes de ce sujet. Parmi les expressions les plus importantes figurent en bonne place « la justice politique », « le bien-vivre-ensemble » et « l’allocation universelle des ressources ». Le premier chapitre s’attèle à fixer les idées sur le contour de ces expressions. La deuxième partie de cette communication est intitulée : « quelques principes de justice politique ». Cette partie présente un corpus de principes de justice applicables au niveau national et au niveau des relations entre les Etats de l’Afrique des grands lacs. Il s’agira des principes que nous considérons comme les plus appropriés en réponse aux défis de la justice et du bien-vivre-ensemble dans la région des pays des grands lacs d’Afrique. La troisième partie de cet article est intitulée : « Démocratisation et allocation universelle des ressources en R.D. Congo et dans les Etats des grands lacs africains ». Cette partie de ce texte essaie de montrer la nécessité de l’enracinement de la démocratie dans tous les Etats de la région des pays des grands lacs et d’une allocation universelle des ressources pour tous les citoyens de tous les Etats des grands lacs africains.
- DEFINITION DES CONCEPTS
Parmi les expressions que nous considérons comme les plus porteuses de signification dans ce sujet figurent : la justice politique, le bien-Vivre-Ensemble, l’allocation universelle des ressources et, dans une mesure plus spatialisante, les pays d’Afrique des grands lacs.
1.1. JUSTICE POLITIQUE
Lorsqu’il est question de la justice, le sens commun est souvent enclin à penser à l’ensemble des institutions de l’ordre judiciaire qui disposent du pouvoir de régler des litiges entre les citoyens. Ces institutions existent en République Démocratique du Congo. Elles comprennent les cours et les tribunaux. Elles statuent sur les cas des conflits entre les particuliers et règlent les questions de la violation des prescriptions relatives aux rapports entre les personnes publiques ou privées. Elles stimulent les populations à bien vivre ensemble au risque de subir des sanctions allant jusqu’à l’emprisonnement.
Cependant, dans le contexte de cette communication, la justice n’est pas considérée dans le sens d’une institution de l’ordre judiciaire. Il s’agit plutôt d’une vertu, d’un ensemble de règles de justice politique dont l’application est considérée comme susceptible de promouvoir une vie harmonieuse entre les citoyens d’un pays ou entre des populations de plusieurs pays pris dans leur ensemble. Et si la justice judiciaire est l’œuvre des juristes, les règles de la justice politique résultent de la réflexion : une réflexion humaine philosophique. 1C’est dans ce sens qu’Aristote définissait la justice comme un ensemble de prescriptions qui disposent les hommes et qui les rendent capables d’accomplir et de continuer à désirer accomplir effectivement des actes justes. L’acte politiquement juste peut ainsi être considéré comme celui qui peut être posé de manière à créer ou à sauvegarder le bonheur d’un individu ou d’une collectivité politique. Et dans une collectivité politique, les actes justes sont posés par ou pour les citoyens en référence à une règlementation considérée elle-même comme juste.
Il existe des règles de justice issues de la pensée théorico-pratique qui pourraient inciter les êtres humains à poser des actes justes et à désirer continuer à les poser pour un bien-vivre-ensemble à la fois individuel et collectif.
1.2. BIEN-VIVRE-ENSEMBLE
De prime abord, par bien-vivre-ensemble, nous n’entendons pas le fait que chacun puisse se contenter uniquement de ce qu’il est sans chercher à être plus ni à avoir plus.
Une telle règle de vie a prévalu dans la réflexion sur la justice dans la Grèce antique où, pour se préserver du désordre, les philosophes estimaient que chacun devait se tenir à sa place de sorte que le fils d’un esclave ne pouvait que naître esclave, le fils d’un cultivateur, cultivateur, le fils d’un militaire soldat, la fille d’une femme ménagère, ménagère. Chacun restant à sa place, l’ordre et l’harmonie pouvait exister au sein de la cité.
Au Kasaï central par exemple, certains adages populaires expriment cette forme de « justice du sur-place » : « udyadya wadya, cibi matandu », « mwenyi katambi tambi mwena ditunga », « bi waya ku Bakuba kudyanji kuteya », « kua mukulu nkudiba, nansha kwashala kana », etc.
Ces adages sont généralement transformés en des règles de conduite d’une « justice du sur-place » de sorte que celui qui dispose des moyens de subsistance et celui qui n’en a pas sont tous invités à rester tranquilles chacun dans son coin et de garder cette distance pour ne pas entrer en conflit.
De même, dans la conscience populaire Luba-Kasaï, un étranger ne peut pas disposer des biens ou des avoirs ou même d’une intelligence supérieurs, un puiné ne peut pas avoir plus de sagesse que son ainé, même le fils de l’aîné doit être considéré comme aîné, même s’il n’est qu’un petit enfant ou un idiot. Cette vision existe dans l’imaginaire populaire des peuples de la République Démocratique du Congo en général et de ceux du Kasaï central en particulier.
Cependant, l’existence de cette vision n’a pas permis de dissiper l’émergence des imaginaires de méfiance, de jalousie, de convoitise, de mépris et même de sorcellerie dans cette diversité où ceux auxquels les circonstances ont permis de disposer de certaines faveurs naturelles ou sociales cohabitent avec ceux qui en sont privés. La société congolaise apparaît d’ailleurs, le plus souvent, comme une société où l’envie, la haine et la discorde sont permanentes et où la sorcellerie, cette sorte de psychopathologie de nivellement par le bas, est presque toujours omniprésente.
Le bien-vivre-ensemble ne signifie pas non plus que certaines personnes puissent vivre au dépend des autres. Dans ce cas, les fruits des efforts des uns devraient satisfaire indument les besoins de vie et de survie des autres. A ce sujet d’ailleurs, un adage de la langue luba Kasaï exclut les personnes faibles d’accès au bien-être : « mufuba kadi biandi ». Cette vision existe aussi dans l’imaginaire collectif des peuples du Kasaï central qui recommande à chacun de travailler pour vivre.
En fait, faire du travail la règle, c’est le lot de la nature humaine : « l’homme vivra grâce à la sueur de son front ». Mais il pourrait toujours y avoir des exceptions : l’existence des personnes faibles, c’est-à-dire celles qui sont handicapées par certaines circonstances sociales ou certaines calamités naturelles.
Etienne de La Boétie écrivait à ce sujet que la nature a fait les hommes différents les uns des autres de sorte qu’elle a donné plus de capacités à certains qu’à la plupart des autres. Il voulait peut-être dire par là qu’il peut exister des personnes naturellement ou même socialement faibles et il en existe dans toutes les sociétés humaines. Ce qui arrive généralement quand ce genre de personnes ne sont pas prises en charge, c’est l’augmentation des comportements de jalousie, de convoitise, de méfiance. Dans une telle société, les conflits d’intérêt sont permanents. Car, d’une manière générale, dans une société où il y en a qui mangent trop alors qu’il y en a qui mangent trop peu, il se pose un problème de justice.
Dans le cadre de ce sujet, par l’expression « bien-vivre-ensemble », nous entendons l’assentiment et l’inclinaison des personnes qui appartiennent à une même communauté à désirer appliquer et à appliquer effectivement des principes de justice qu’ils considèrent comme les plus à même de créer entre eux une vie harmonieuse malgré les diversités naturelles, les différences socio-culturelles ou familiales qui les caractérisent.
En nous référant notamment à la théorie de la justice de J. Rawls, nous essaierons de montrer comment une telle vie d’ensemble est possible.
1.3. ALLOCATION UNIVERSELLE DES RESSOURCES
L’expression « allocation universelle » des ressources, nous l’empruntons à Yannick Vanderborght et Philippe Van Parijs. 1En effet, dans un ouvrage intitulé L’allocation universelle, Yannick Vanderborght et Philippe Van Parijs estiment qu’il est impossible de penser l’avenir de la protection sociale des populations du monde aujourd’hui sans évoquer « l’idée de verser sans conditions à tous les citoyens un revenu de base, cumulable avec tout autre revenu ». Un revenu de base est en effet une ressource financière dont un citoyen peut disposer même s’il n’a aucun autre revenu. Ce revenu lui permettra d’être assuré d’un avoir qui peut lui permettre de vivre, de survivre et d’entrevoir la possibilité de continuer à rechercher un emploi pour une meilleure satisfaction de ses désirs. Ce revenu peut s’ajouter à d’autres revenus qu’il peut obtenir notamment quand le citoyen a trouvé du travail. C’est pour cela qu’il est cumulable. On ne pourrait donc pas priver ce revenu à un citoyen en tenant compte des autres revenus dont il pourrait disposer.
Une allocation universelle des ressources est donc une stratégie de justice par laquelle une communauté politique verse un revenu à tous ses membres, sur une base individuelle, sans contrôle de ce que chacun possède à l’avance. Chacun disposera du revenu ainsi alloué sans discrimination et sans exiger une contrepartie. Le principe d’une justice par allocation universelle requiert donc que les pouvoirs publics versent à chaque citoyen en l’occurrence une somme d’argent qui puisse lui servir de base à la poursuite de son bien sans demander à ce citoyen ni de travailler pour obtenir ce revenu, ni de procéder à un quelconque remboursement. Cette stratégie peut faire ressembler une démocratie à un Etat providence.
Yannick Vanderborght et Philippe Van Parijs évoque par exemple le scénario de l’application du principe d’une allocation universelle au Brésil. C’était le 8 janvier 2004 au palais présidentiel de Brasilia. Une décision présidentielle avait été prise pour octroyer à chaque Brésilien un revenu de base sans discrimination. Le versement de ce revenu devait immédiatement commencer avec les Brésiliens les plus nécessiteux et la généralisation se ferait graduellement à toute la population.
Il est possible que l’octroi de ce revenu n’ait pas résolu tous les problèmes de justice sociale des Brésiliens. Néanmoins, sa généralisation avait pour objectif de permettre à chaque citoyen de vivre avec une allocation minimum de survie. La généralisation de cette allocation pourrait être à même de couvrir les besoins des citoyens du Brésil mais elle pourrait aussi briser les chaînes de la misère et de la convoitise entre les citoyens des pays voisins en cas de nécessité.
Ce principe d’une allocation universelle peut être généralisé d’avantage et être adopté non seulement en faveur des citoyens de la République Démocratique du Congo et de tous les peuples de la région de l’Afrique des grands lacs mais aussi entre tous les citoyens de tous les Etats voisins de la R.D. Congo.
1.4. PAYS DES GRANDS LACS
Il n’est peut-être pas nécessaire de faire une cartographie des pays de la région africaine des grands lacs. On pourrait néanmoins savoir que la région africaine des grands lacs comprend : la République Démocratique du Congo, le Burundi, le Rwanda, l’Ouganda, le Kenya et la Tanzanie.
Cette partie de l’Afrique a des limites naturelles avec la République Démocratique du Congo notamment grâce à la présence des lacs Albert, Edouard, Kivu, Tanganyika et le lac Mwero. C’est cette partie de l’Afrique qui se retrouve aujourd’hui au centre d’un conflit armé qui dure depuis près de 30 ans : les armées rwandaises, ougandaises, burundaises, Tanzaniennes, etc. s’affrontent en inimitié ou en amitié avec l’armée rd congolaise ainsi qu’avec les milices présentes sur le sol congolais. 1En effet, parmi les milices qui endeuillent et ensanglantent l’est de la RD Congo figurent les Forces Démocratiques pour la libération du Rwanda (FDLR) qui sont venues du Rwanda et qui sévissent à l’est de la République Démocratique du Congo depuis plus de 30 ans. On y retrouve aussi principalement le M23 (une milice prétendument congolaise qui se bat pour renverser les institutions qui sont en place en RD Congo depuis plusieurs années), les ADF (Allied Democratic Forces, « Forces Démocratiques Alliées », qui sont une milice ougandaise qui opère à l’est de la RD Congo depuis plus de très longtemps ) et les CODECO (Coopérative pour le Développement du Congo, une faction de l’armée RD congolaise qui affronte l’armée congolaise en Ituri depuis plusieurs années). Il faut ajouter à cette liste la présence et l’activisme d’un autre groupe armé à l’est de la RD Congo, les Wazalendo, une milice armée qui se bat aux côtés de l’armée RD Congolaise pour protégé l’intégrité territoriale du pays et empêcher sa balkanisation.1Dans cette communication, nous pensons qu’une application des principes de justice politique « justes » pourraient venir à bout des conflits et des affrontements et promouvoir le bien-vivre-ensemble entre les citoyens de la République Démocratique du Congo d’une part et entre les citoyens de la République Démocratique du Congo et les autres citoyens des pays de la région africaine des grands lacs d’autre part.
2. QUELQUES PRINCIPES DE JUSTICE POLITIQUE
Dans cette deuxième partie de ce sujte, nous proposons six principes que nous considérons comme ceux dont l’application est à même d’infléchir positivement le bien-vivre-ensemble en RD Congo d’une part et entre la RD Congo et les autres Etats de l’Afrique des grands lacs d’autre part. Ces principes s’inspirent du principe volontariste d’Emmanuel Kant, du principe de la responsabilité de Hans Jonas, du principe de justice comme équité de John Rawls et du principe de justice politique de Ngoma Binda. Ces principes ont l’avantage de placer l’éthique au centre de l’action politique. Il s’agit de six principes suivants : le principe de non-malfaisance, le principe de fidélité, le principe de la reconnaissance, le principe de restauration, le principe d’impartialité et le principe d’équité.
2.1. PRINCIPE DE NON-MALFAISANCE
Le principe de non-malfaisance impose le devoir de ne pas faire du mal à autrui. Il a peut-être une origine dans la religion mais il s’est imposé sous plusieurs formes dans les théories morales.
En effet, la religion repose notamment sur le commandement d’aimer son prochain comme soi-même : « tu aimeras ton prochain comme toi-même… l’amour ne fait point de mal au prochain ». Cela implique que si on aime autrui, on ne peut ni le tuer, ni lui voler, ni le tromper, ni lui faire une fausse promesse, ni lui priver de ce à quoi il a droit. La raison est simple : on n’admettra pas qu’il en soit ainsi fait à l’égard de soi-même.
Kant a peut-être su mieux théoriser le principe de la non-malfaisance dans la théorie morale avec son impératif catégorique : « agis uniquement d’après la maxime qui fait que tu peux aussi vouloir que cette maxime devienne une loi universelle » ou encore « agis de telle sorte que la maxime de ta volonté puisse en même temps valoir comme principe d’une législation universelle ».
Cette formulation kantienne du principe de la non-malfaisance s’applique aux individus et concerne une législation universelle publique. Pour Kant donc, on n’a pas le droit de faire du mal à autrui parce qu’on n’acceptera pas qu’autrui fasse de même. Faire du mal ne peut donc pas devenir une loi universelle. C’est pour cela qu’une morale publique condamne celui qui fait du mal à autrui. 1
Si ce principe est appliqué en RD Congo et dans les autres Etats des grands lacs, on ne se battrait pas. Au contraire l’application du principe de non-malfaisance serait à même d’améliorer le bien-vivre-ensemble du fait qu’autrui – personne ou Etat -, serait considéré comme un objet d’amour et de bienfaisance.
Le principe de non malfaisance est donc au fondement du bien-vivre ensemble des citoyens d’une manière générale et des Etats regroupés comme ceux de l’Afrique de la région des grands lacs d’une manière particulière. Ngoma Binda recommande à ce sujet d’agir « de telle sorte que, examinant rationnellement les conséquences de ton acte politique, ce dernier soit pris comme un modèle de sagesse et que jamais tu ne fasses aux autres ce qui aurait des conséquences que tu n’accepterais jamais qu’on te fasse subir ». Nous avons estimé que les actes politiques sont ceux qui sont posés par ou pour les citoyens dans une société bien ordonnée par des principes de justice. Ces actes seront posés en amont ou en aval, en suivant le principe de justice politique de Ngoma-Binda, sans nuire au bien-être d’autrui, citoyen ou Etat.
2.2. PRINCIPE DE FIDELITE
Il s’agit ici du devoir pour autrui – personne ou Etat-, de s’acquitter des engagements qu’on a librement consentis. C’est pour cela que le principe de fidélité se comporte comme dans le cas d’une promesse.1En effet dans le cas d’une promesse, si quelqu’un s’engage et promet de faire « X » dans des circonstances appropriées, il doit faire « X » si ces circonstances sont réalisées. De ce fait, le fait de faire « X » est un gage de fidélité à la promesse. La fidélité à la promesse entraîne donc une obligation quasi automatique d’agir dans ce sens. C’est en fonction de ce principe que les citoyens et les Etats éprouvent l’obligation d’obéir, comme l’écrit John Rawls, à des lois promulguées sous une constitution démocratique considérée comme juste ». L’application du principe de fidélité est un gage du bien-vivre-ensemble entre les citoyens d’un Etat d’une part et entre des Etats pris ensemble d’autre part. C’est dans ce sens que des accords qui pourraient être conclus entre les citoyens ou entre les Etats pourraient être respectés et appliqués. Dans le cas contraire, l’infidélité pourrait conduire à la méfiance et même à des pires formes de discordes comme il en existe entre la RD Congo et ses voisins de l’est de l’Afrique des grands lacs.
2.3. PRINCIPE DE RECONNAISSANCE
Les actions humaines obéissent aussi à l’obligation et au devoir de témoigner de la gratitude envers les apports, le soutien ou l’aide que l’on a reçus. Témoigner de la reconnaissance peut parfois se résumer au fait de dire « merci » ou de rendre la pareille.
Le principe de reconnaissance implique donc le devoir, pour chaque personne morale et pour chaque Etat démocratique, de remercier autrui – personne ou Etat-, des bienfaits dont on a été bénéficiaire et de lui faire aussi du bien, de lui apporter de l’aide en cas de nécessité. Ce principe est donc aussi, d’une certaine manière, un principe de réciprocité. A travers ce principe, il se réalise une forme d’harmonisation des intérêts sociaux. Aucune personne ou aucun Etat ne sera enclin à faire des profits chacun au frais de l’autre du fait que « seuls des avantages réciproques sont autorisés ». De la sorte le principe de reconnaissance est au cœur du bien-vivre-ensemble qu’il soutien et qu’il favorise. Car la réciprocité permet de déterminer les termes équitables de coopération entre les citoyens et entre les Etats.
2.4. PRINCIPE DE RESTAURATION
Les actions humaines peuvent être aussi évaluées en rapport avec le devoir pour chacun –personne ou Etat-, de reconnaître ses propres torts et de les réparer.
Il est toujours possible que dans une vie d’ensemble, dans une activité d’ensemble ou dans toute circonstance qui implique deux ou plusieurs personnes et deux ou plusieurs Etats, qu’une erreur, une faute ou une mésentente surviennent. Il y a un devoir moral pour l’auteur de la faute d’accepter sa faute et si la faute a été accompagnée des dégâts, d’accepter de réparer ses dégâts en vue de rétablir l’harmonie et l’entente. Le principe de restauration agit comme un principe de responsabilité. Chacun, personne ou Etat est responsable de ses actes et doit réparer ses torts en cas d’une faute ou d’une erreur qui ont été accompagnées des dégâts, des casses ou des tueries. C’est en cela aussi que consiste la justice entre les personnes et entre les Etats, gage du bien-vivre-ensemble. C’est peut-être dans ce sens qu’actuellement, un des pays de la région africaine des grands lacs est en train de payer à la RD Congo une indemnisation pour les dégâts causés par l’armée congolaise dans la guerre de Kisangani. L’application du principe de restauration devrait s’accompagner de la conviction d’éviter des fautes et des dégâts dans les relations publiques.
2.5. PRINCIPE D’IMPARTIALITE
Les actions des citoyens et des Etats pourraient aussi être considérées comme justes d’après leur capacité à jouer le rôle qui leur a été préalablement assigné et à produire les effets escomptés sans parti pris et sans chercher à en tirer un gain personnel.
En effet, l’impartialité recommande donc aux personnes et aux Etats d’agir sans discrimination. A l’intérieur des Etats, les droits égaux des citoyens seront redistribués d’une manière égale à toutes les personnes concernées. On évitera ainsi des pratiques fondées sur des préjugés ou sur l’intérêt personnel. Entre les Etats, on appliquera les conventions, les traités et les accords sans chercher à privilégier les intérêts de tel Etat contre tel autre. Les accords conclus et considérés comme justes s’appliqueront à tous sans distinction et ne pourrons souffrir d’aucune distorsion.
L’application du principe d’impartialité peut créer une vie harmonieuse entre les citoyens et entre les Etats. Chacun, chaque Etat, prendra soin chaque fois de traiter les cas semblables d’une manière semblable en restant dans les limites de ce qui est rationnel et de ce qui est raisonnable et de la juste mesure.
2.6. PRINCIPE D’EQUITE
Le principe d’équité consiste à aligner toute conduite publique sur ce qui est considéré comme juste par tous les citoyens ou par tous les Etats. Ce principe inclut l’impartialité, l’intégrité, la droiture, la probité et même une certaine forme de l’égalité. C’est un principe de justice juste comme les principes de non-malfaisance, de fidélité, de reconnaissance, de restauration et d’impartialité.
Le principe d’équité recommande notamment de traiter chaque fois les cas semblables d’une manière semblable et là où il apparaîtra des différences, de prendre toujours en compte d’augmenter les avantages rationnels des personnes ou des Etats les plus désavantagées. Il peut s’agir des malades, des invalides ou des personnes que certaines circonstances fortuites ont rendu incapables ou peu habiles. Il peut aussi s’agir des personnes ou des Etats défavorisés par la nature ou par des calamités sociales en l’occurrence les Etats ne disposant pas d’assez de ressources naturelles. Ce principe recommande de leur venir en aide, de leur apporter le minimum dont ils ont besoin pour se maintenir dans l’existence. Ces personnes ou ces Etats devront être traités de manière à renforcer leurs capacités et à avoir accès à une plus-value et à plus de bien-être.
L’équité, c’est aussi de réserver à chacun la jouissance des droits auxquels il a droit et de faire bénéficier aux plus défavorisés des droits auxquels ils ne pourraient pas accéder par eux même. Les plus défavorisés peuvent être des personnes ou des Etats. John Rawls a présenté un principe d’équité en trois volets de la manière suivante : « chaque personne a une même prétention indéfectible à un système pleinement adéquat de libertés de base égales, qui soit compatible avec le même système de libertés pour tous ; et les inégalités économiques et sociales doivent remplir deux conditions : elles doivent d’abord être attachées à des fonctions et des positions ouvertes à tous dans des conditions d’égalité équitable des chances ; ensuite, elles doivent procurer le plus grand bénéfice aux membres les plus défavorisés de la société ». Ce principe détermine la manière dont les droits et les libertés de base, les inégalités économiques et sociales ainsi que les membres de la société les plus désavantagés devraient être gérés. De la même manière que ce principe s’applique aux personnes, ils pourraient aussi s’appliquer aux Etats.
Ces principes pourraient trouver leur meilleure application dans une société démocratique juste. En fait, une société démocratique juste est celle dans laquelle ces principes sont à l’œuvre et commandent toute conduite publique et établissent l’harmonie et le bien-vivre-ensemble entre les citoyens et les Etats.
A quelles conditions ces principes pourraient-elles s’appliquer par ou pour les citoyens des Etats d’Afrique des grands lacs ? La troisième partie de cet article va essayer de répondre à cette question.
3. DEMOCRATISATION ET ALLOCATION UNIVERSELLE DES RESSOURCES EN R.D. CONGO ET DANS LES ETATS DES GRANDS
Deux situations peuvent être considérées comme les plus à même de juguler les conflits, les rébellions et les guerres entre les citoyens et les Etats d’Afrique centrale. Il s’agit d’une part de la démocratisation de tous les Etats de la région des grands lacs et, d’autre part, d’une juste allocation universelle des ressources au sein de ces Etats.
3.1. DEMOCRATISATION
Lorsque Raymond Boudon fait l’éloge du sens commun, il estime qu’aujourd’hui, il y a une idée qui s’est enracinée dans les esprits, c’est « l’idée selon laquelle il n’existe pas de meilleur système d’organisation de la Cité que la démocratie ».
En effet, la démocratie se présente comme un régime politique qui refuse la violence et la malfaisance. La violence peut surgir dans toutes les relations humaines. Elle peut apparaître à l’intérieur comme à l’extérieur des sociétés ou des groupes. Mais la démocratie, grâce ses valeurs fondamentales de la tolérance, de la liberté et de l’égalité, se donne pour mission de lutter non seulement contre le mal et la violence qui se commettent à extérieur, mais aussi contre des maux qui se commettent à l’intérieurs-même des Etats. Elle cherche ainsi, pour tous les citoyens et pour tous les Etats, la sécurité et la justice.
Dans les paragraphes ci-dessus, nous avons montré que la justice consiste notamment à ne pas faire du mal à autrui, à rester fidèle à ses engagements, à donner à chacun ce à quoi il a droit et à accorder aux personnes les plus défavorisées la possibilité d’accéder aux moyens de subsistance et aux avantages sociaux. Ngoma Binda écrit à ce sujet que « la démocratie est l’autre nom de la sagesse politique, de la rationalité et de la moralité dans l’agir politique » dans la mesure où ces principes en sont des piliers.
En effet la sagesse démocratique consiste en effet à ne pas faire du mal à autrui et à donner à chacun ce à quoi il a droit de manière à lui assurer la sécurité et le bien-être. Une démocratie ne peut dons pas fonctionner utilement dans une société où il y en a qui mangent trop alors qu’il y en a qui mangent trop peu. Elle ne peut pas fonctionner non plus dans une société où il n’y a pas de dialogue politique, c’est-à-dire la possibilité de se mettre ensemble autour d’une même table et d’engager une négociation menant à un compromis sur les questions qui divisent les citoyens ou les Etats.
La RD Congo se veut un Etat démocratique caractérisé notamment par des élections libres dans une égalité des conditions de tous les citoyens. Elle se veut aussi un pays où le dialogue, l’alternance politique dans les fonctions les plus avantageuses et la justice sont possibles. Elle pourrait constituer un exemple pour les autres Etats de l’Afrique des grands lacs.
En effet, la démocratie est toujours rivée à une volonté politique ferme des dirigeants et des citoyens, une volonté qui ne peut cesser d’être présente. Car la démocratie est toujours une tension vers plus de justice, plus de sécurité et plus de bien-être. Elle n’est jamais finie. Elle n’est jamais finie parce qu’elle est toujours une aspiration morale et sociale par laquelle une communauté tente de « s’organiser collectivement pour protéger les êtres humains des dangers vitaux, pour lutter contre les catastrophes et les agressions, contre la disparition en général et la guerre en particulier ».
La région africaine des pays des grands lacs comprend donc un Etat dont l’aspiration à la démocratie est le plus avouée. C’est la République Démocratique du Congo. Et le moins que l’on puisse dire des autres Etats d’Afrique des grands lacs pauvres en l’occurrence le Rwanda, le Burundi et l’Ouganda est qu’ils sont des Etats dirigés par des régimes militaires à caractère belliciste comme s’il s’agissait des va-t-en-guerre. Ces Etats sont enclins à rechercher et à trouver des espaces d’entraînement pour leurs soldats et des terrains d’expérimentation de leurs armements. C’est peut-être pour cela que leurs capacités de faire la guerre et d’aguerrir leurs soldats trouvent en RD Congo un terrain d’entrainement de prédilection en même temps qu’un moyen de sortir de la pauvreté et de satisfaire leurs besoins sociaux et économiques. Cette situation peut être aussi considérée comme étant à la base de la situation chaotique vécue en RD Congo en général et dans sa partie est en particulier.
Qu’à cela ne tienne, une démocratie ne peut pas fonctionner réellement si on n’envisage pas la possibilité d’une juste allocation universelle des ressources et des revenus.
3.2. JUSTE ALLOCATION DES RESSOURCES
L’expression allocation des ressources que nous utilisons ici s’oppose à une allocation naturelle des ressources.
En effet, une allocation naturelle des ressources c’est la manière dont la nature attribue ce dont elle dispose aux uns et aux autres de manière différente. Etienne de la Boétie estimait à ce sujet que la nature dispose des biens qu’elle peut distribuer comme elle veut. Il peut s’agir des biens matériels ou des biens de l’esprit. Elle peut donner plus aux uns et moins aux autres. Les uns seront ainsi plus forts que les autres.
Etienne de la Boétie écrivait à cet effet qu’« et si, faisant le partage des présents qu’elle nous faisait, elle a fait quelques avantages de son bien, soit au corps ou à l’esprit, aux uns plutôt qu’aux autres, si elle n’a pourtant entendu nous mettre dans ce monde comme dans un camp clos, et n’a pas envoyé ici-bas les plus forts ni les plus avisés, comme des brigands armés dans une forêt pour y gourmander les plus faibles ». Selon Etienne de la Boétie, la nature peut distribuer les biens dont elle dispose comme elle le veut. Il va se retrouver que les uns qui ont reçu plus seront plus forts et plus avisés que les autres qui ont reçu moins. Mais Etienne de la Boétie ajoute que cette situation ne doit pas être considérée par les plus forts comme une occasion pour eux de maltraiter les plus faibles ou de les « brigander ».
Or précisément, abandonner à eux-mêmes dans la situation d’inégalité, les plus forts auront toujours tendance à écraser les plus faibles. Une juste allocation universelle des ressources est une manière de corriger les différences causées par une distribution des ressource abandonnée à la nature.
A cet effet, une distribution universelle des ressources est une manière, pour les pouvoirs publics, de corriger les inégalités entre les citoyens d’un Etat ou entre les Etats regroupés comme ceux de la région africaine des grands lacs. Elle consiste, comme nous l’avons déjà indiqué, à attribuer notamment un revenu de base égal à tous les citoyens sans contrepartie. Et cette allocation ne peut être juste que si elle est décidée de commun accord dans une société démocratique gouvernée par les principes de justice que nous les avons évoqués.1En République Démocratique du Congo, une forme élémentaire de début de l’application d’une justice par allocation universelle existe. Elle consiste notamment en la gratuité de l’éducation de base pour la jeunesse congolaise, la gratuité de la maternité pour les femmes qui accouchent et même en l’octroi de quelques bourses d’étude à des lauréats du cycle du secondaire. Il faut ajouter à cela l’allocation d’une assurance santé aux professeurs d’université.
La RD Congo est peut-être le seul pays en Afrique ou au monde où les chemins sont tracés en marchant petit à petit. C’est pour cela que nous pensons que les actions déjà engagées dans le sens d’une allocation gratuite des revenus constituent une bonne indication. Mais elles sont encore insuffisantes. Le jour où chaque congolais aura le droit de bénéficier d’un revenu de base gratuit, la lumière qui illuminera chacun des visages des congolais portera le signe d’espoir que les comportements de jalousie, d’envie, de sorcellerie ou de convoitise cèderont la place à la fraternité et à la solidarité. Les Congolais pourront alors commencer à bien vivre ensemble et désirer continuer à bien vivre au Congo. Il en est de même pour tous les citoyens des Etats de l’Afrique des grands lacs. La nature a peut-être alloué plus de ressources naturelles à la RD Congo qu’à ces autres Etats. Une répartition juste des revenus de ces ressources entre tous les Etats de la région africaine des grands pourraient être une garantie de la paix et de la stabilité.
CONCLUSION
Nous avons indiqué dans les pages précédentes que le bien-vivre-ensemble passe par l’application des principes de justice dans une société démocratique. Telle est la meilleure manière d’éviter des conflits causés par des situations de guerres d’hégémonie. Il faudra en plus mettre en place une stratégie courageuse d’allocation universelle des ressources et des revenus de manière à corriger les écarts dus à une répartition trop naturelle.
Pour créer des conditions propices au bien-vivre-ensemble en République Démocratique du Congo et entre la République Démocratique du Congo et les autres Etats de la région africaine des grands lacs il faut :
✓ Stimuler la déconstruction systématique des régimes à caractère militaire. En effet, comme nous l’avons dit précédemment, la RD Congo est dirigée par un régime à caractère démocratique tandis que les autres Etats de la région des grands lacs sont dirigés par des régimes militaristes. Comme on le sait, les militaires réagissent comme des lions toujours prêts à tuer même pour se faire plaisir. Tandis que les démocrates agissent comme des agneaux toujours prêts à discuter, dialoguer et même supplier pour se faire entendre. On ne peut pas laisser le lion et l’agneau vivre côte à côte.
✓ Promouvoir la démocratisation de tous les pays de la région des grands lacs. Une des causes profondes des guerres et de la violence dans la région des grands lacs, c’est la coexistence côte à côte d’un pays qui se veut démocratique avec des pays gouvernés par des militaires à caractère totalitaire. Cette situation ne peut jamais favoriser ni le bien-vivre-ensemble en tant qu’Etats ni faciliter le bien-vivre-ensemble des citoyens de ces Etats. Dans une société gouvernée par des principes de justice, des cas semblables devraient être traités d’une manière semblable. Mais dans le cas de la RD Congo et ses voisins de la région des grands lacs, les cas sont différents. Pour qu’il soit possible d’harmoniser les perspectives, il faut que tous les Etats soient gouvernés par des principes démocratiques.
✓ Promouvoir la création d’une zone de libre-échange sous forme d’un marché commun des Etats des grands lacs avec une monnaie unique et une banque des Etats des grands chargés de réguler la circulation de cette monnaie entre les Etats et les citoyens des Etats des grands lacs. Cette banque aura aussi la charge de financer les investissements et le développement harmonieux des Etats de la région.
✓ Stimuler la fédération de les tous les Etats d’Afrique des grands lacs. Il s’agit ici de promouvoir la fusion des Etats de la région africaine des grands lacs en un seul pays dénommé Etats Unis d’Afrique des Grands Lacs, en sigle « EUAGL » à l’instar et avec l’accompagnement des Etats Unis d’Amérique. Cette fédération se présentera comme un seul pays composé de plusieurs Etats ayant des dimensions variables mais fonctionnant sur un mode de gestion démocratique. Une Constitution unique déterminera les grandes lignes de la gestion fédérale de cet Etat.
✓ Mettre en place une stratégie d’ allocation universelle des ressources et des revenus entre tous les citoyens des Etats Unis d’Afrique des Grands Lacs. Ce sera une manière de diminuer la convoitise, la jalousie et la haine entre les citoyens de la fédération. Le fait que la RD Congo dispose des ressources naturelles immenses et de la possibilité de transformer ces ressources en richesse constitue un objet de convoitise des autres pays pauvres de la région. Un système de péréquation sera mis en place qui permettra une redistribution équitable des richesses entre les Etats et l’octroi d’un revenu sans contrepartie à chaque citoyen pour couvrir ses besoins de base et lui permettre de survivre.
Lorsque le conseil de sécurité des nations unies a pris la résolution 2773 en vue de régler les différends entre le Rwanda et la RD Congo, il propose notamment : le renforcement de l’autorité de l’Etat et de la gouvernance à l’est de la RDC. Ce renforcement de l’autorité d’un Etat démocratique dans les voisinages d’un Etat à caractère militaire peut se présenter comme un défi à relever et un motif de blocage. Car, un Etat à caractère militaire ne peut comprendre que le langage de la violence. Il ne peut pas tolérer le pacifisme d’un Etat démocratique dans ses frontières. S’il est en fait entendu qu’un Etat qui veut la paix avec les autres Etats prépare la guerre, la République démocratique du Congo doit procéder à une réforme profonde de son armée. Mais il ne sera pas question d’appliquer la loi de talion mais de rechercher la paix en dotant la fédération des Etats d’Afrique des grands lacs d’une armée forte et dissuasive. Car, une bonne fédération démocratique ne peut pas survivra sans une armée conséquente.
Ce dont on a besoin en Afrique des grands lacs pour un bien-vivre-ensemble comme Etat et comme peuples, c’est le refus de la violence et l’application des principes de justice comme le principe de non-malfaisance, le principe de fidélité, le principe de reconnaissance, le principe de restauration, le principe d’impartialité et le principe d’équité. Ces principes ne pourraient trouver leur terrain de prédilection qu’à l’intérieur d’un Etat démocratique. Il va sans dire que la non application de ces principes dans la région africaine des grands lacs continuera à alimenter les conflits et la violence. Aucune paix durable ne sera donc pas possible.
BIBLIOGRAPHIE
ARISTOTE, Ethique à Nicomaque, Traduction, préface et notes par J. Voilquin, Paris, Garnier-Flammarion, 1965.
BOUDON, R., Renouveler la démocratie. Eloge du sens commun, Paris, éd. Odile-Jacob, 200
CARATINI, R., Initiation à la philosophie, Paris, Archipel, 2000.
CORENTIN, D. S., La tradition de la liberté. Tome II Les lumières libérales.
Synthèse détaillée de textes majeurs de la tradition libérale, Paris, Elf, SD.
DICKENS, O., Comprendre Kant, Paris, Armand Colin, 2003.
HANS, J., Le principe responsabilité. Une éthique pour la civilisation technologique,Paris, éditions du CERF, 1995.
HOBBES, T., Léviathan : deuxième partie. Traduction de P. Folliot, 2004.
KANT, E., Vers la paix perpétuelle, trad. Poirier/Proust, Paris, Garnier-Flammarion, 1991.Fondements de la métaphysique des mœurs, Paris, Gallimard, 1985.
KUNZMANN, P. et al., Atlas de la philosophie, Paris, Librairie générale française, 1999.Le code de procédure judiciaire, par exemple.
MFUAMBA KATENDE, M.P., Justice politique et démocratie chez J. Rawls. Repères pour une rationalité politique africaine contemporaine, Berlin, Editions universitaires européennes, 2018.
NGOMA-BINDA, P., La pensée politique africaine contemporaine, Paris, L’Harmattan, 2013.
« Multi-éthnicité et gestion du pouvoir politique », in Paix et résolution pacifique des conflits durant la transition démocratiue au Zaîre
Actes du colloque naional tenu à Kinshasa, du 22 au 26 août 1994, publication du CNONGD, Kinshasa 1996.
ONANA, C., Holocauste au Congo. L’Omerta de la communauté internationale, Paris, édition de l’Artilleur/Toucan, 2023.
RAWLS, J., Théorie de la justice, Paris, éd. Points, 2009.
La justice comme équité. Une reformulation de Théorie de la justice, Paris, éd. La Découverte, 2008.
RENAULT, A., La philosophie, Paris, Odile Jacob, 2006.
VANDERBORGHT, Y. et al., L’allocation universelle, Éditions La Découverte, Paris, 2005.
WORMS, F., Les maladies chroniques de la démocratie, Paris, éditions Desclée de Brouwer, 2016.




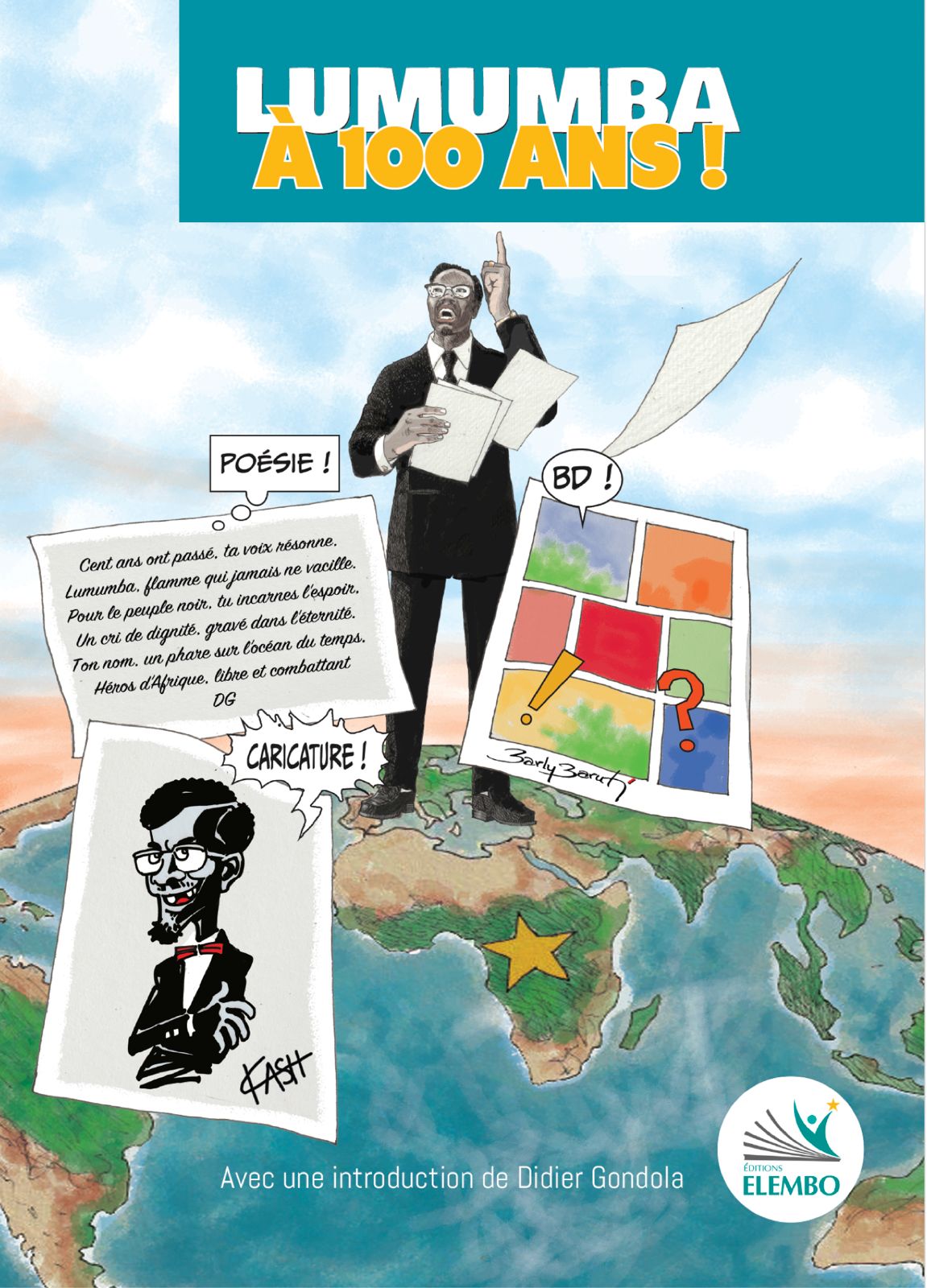

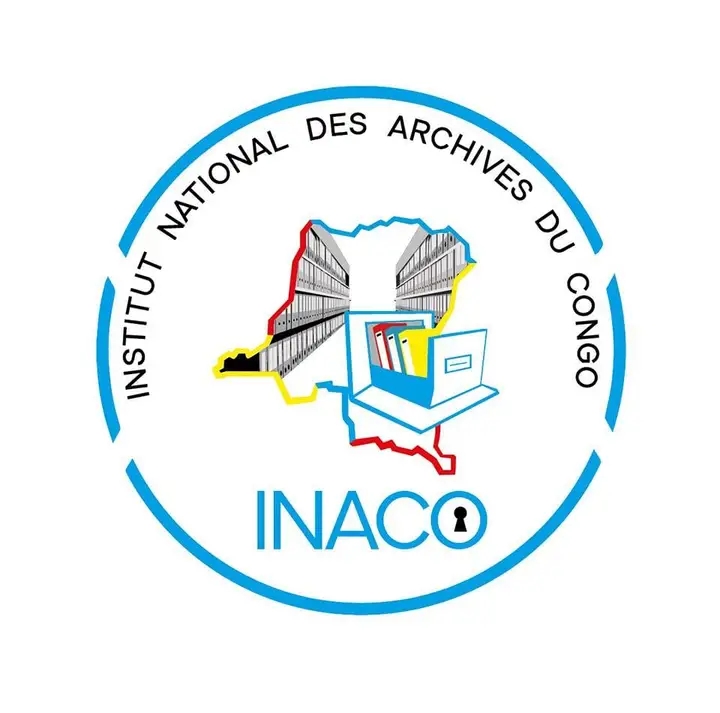





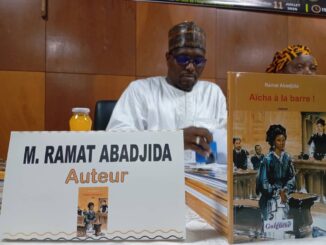
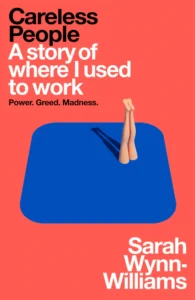
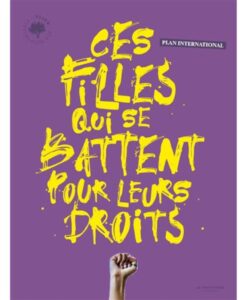

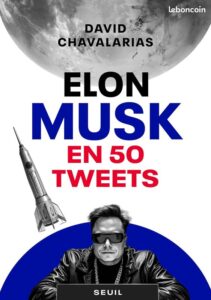



Laisser un commentaire