La violence a pendant longtemps été appréhendée comme un attribut masculin étranger à la gent féminine. Lorsqu’on aborde la question de la violence, de quelque nature qu’elle soit, on pense directement à l’homme, naturellement fort, aux caractères imposants avec un esprit de domination et de combativité. Dès lors, cela génère de contradictions, ou, tout au moins, de surprises majeures lorsqu’on parle de la violence des femmes. Autrement dire, on s’étonne qu’on puisse parler, par exemple, de la violence de la femme sur les hommes tant celles-ci sont supposées être les passives, les soumises et les éternelles victimes de la violence masculine. Cette manière d’appréhender la question de la violence dans le rapport de l’homme et de la femme fausse pourtant le débat et substitue l’imaginaire à la réalité, le subjectif à l’objectif. Pour mettre la pendule à l’heure, Elisabeth Badinter, féministe égalitariste française fait partie de ses rares femmes à s’intéresser à la question. Dans Fausse route, un essai qu’elle publia en avril 2003 et paru aux éditions Odile Jacob à paris, elle va consacrer tout un chapitre à l’une des questions les plus absentes dans l’histoire de la littérature en générale et dans le féminisme en particulier : la violence des femmes. Peut-on parler d’un sadisme féminin ? Les femmes ont-elles aussi, à l’instar des hommes, des pulsions violentes ou sont-elles les éternelles innocentes victimes de la violence masculine ? Ce sont des questions auxquelles la féministe apporte de réponses claires, limpides et explicites.
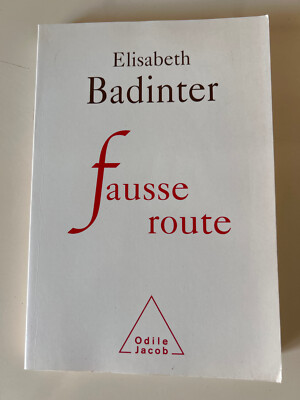
La question de la violence des femmes est en effet quasiment absente dans l’Histoire. Mais cela est loin de signifier qu’elle est inexistante. Les femmes, estime la féministe, ont toujours été aussi violentes que les hommes sont violents. Néanmoins, si cette violence est moins discutée – ou pas du tout discutée -, c’est parce qu’« elle a été longtemps ignorée ou minorée ». Pour justifier cette hypothèse, Badinter s’est appuyée sur quelques violences majeures dont les femmes ont fait preuve dans l’Histoire politique. Elle s’est intéressée, pour commencer, à la participation des femmes à la mise en œuvre du nazisme. Selon elle, un tel massacre n’a pas pu avoir lieu sans la participation des femmes, partisantes du système hitlérien. Explicitement, les femmes ont joué de très grand rôle dans ce génocide notamment dans les aspects prépondérants du système d’expropriation, de spoliation et de délation des Juifs en Allemagne. Ce sont là, des catégories de femmes impliquées moins activement et indirectement dans le massacre. Mais en dehors de ces dernières, Elisabeth Badinter fait état des femmes « engagées dans le système idéologique et matériel de la persécution ». Dans ce rang, on peut citer les femmes de la SS, l’organisation paramilitaires et policière fondée par Adolf Hitler en 1925 qui comptait un nombre impressionnant de femmes. De plus, nombreuses sont les intellectuelles et les universitaires qui ont contribué au dynamisme du génocide. La majorité des dénonciations ont été effectuées par des femmes, soit par civisme, soit par loyauté ou simplement par pure pulsion de violence.
Une étude analogique du génocide rwandais révèle et plus encore, que le sadisme n’a pas de sexe et que l’homme n’a pas le monopole de la violence. Le génocide rwandais, il faut le rappeler fait partie des plus meurtriers de l’histoire. Et ici aussi la part des femmes dans ce massacre de filles, de fils, d’enfants, de femmes, d’hommes et même de fœtus laisse sans voix. Sur les 120 000 personnes identifiées comme accusées du génocides, 3 564 sont des femmes. Sur l’effectif total des génocidaires, cela fait 3,5%. Un pourcentage faible certes, mais suffisant pour mettre fin au mythe de l’éternelle innocente de la femme dans la violence. Si 3 000 femmes n’ont pas hésité à tuer, à coup de machettes des enfants, des femmes enceintes, des jeunes gens, des pères et des mères de famille, on ne saurait conclut à l’incapacité de la femme à être violente au même titre que les hommes. Il y a des hommes violents, des femmes violentes et des hommes doux et pacifiques et des femmes douces et pacifiques. En Europe, pour la toute première fois dans l’Histoire, une femme a été condamnée en 2003 par le Tribunal pénal international de La Haye pour crime contre l’humanité. Il s’agit de Biljana Plasvic, soixante-douze ans, condamnée à onze ans d’emprisonnement pour sa participation jugée trop prépondérante dans la politique serbe d’épuration ethnique durant la guerre de Bosnie entre 1992 et 1995.
L’une des conséquences de ces chiffres – non exhaustifs vu que la question est très peu discutée -, c’est la remise en cause du monopole de la violence conjugale qu’on attribue à raison ou à tort à l’homme. Dans les foyers, des hommes sont, il faut le reconnaître, aussi victimes de femmes dominantes et violentes. Toutefois, on se demande si cet état de chose suffit pour conclure à la confirmation de la thèse de l’asymétrie de la violence entre l’homme et la femme. Nous ne saurons répondre à l’affirmative. Parce qu’une idée selon laquelle l’homme et la femme seraient égaux en violence est à la limité injuste et vide de sens. Ce qu’on ne saurait nier cependant, c’est le réalisme de la vie de couple. Dans un couple, la violence est inévitable, qu’elle soit verbale ou physique. Par conséquent, soit c’est l’homme le bourreau, ce qui est le plus souvent le cas en matière de violence physique, soit c’est la femme, particulièrement en violence morale et psychologique. On pourrait imaginer d’office que si pendant longtemps les femmes et les féministes ont fait fi de la réalité de la violence féminine, c’est parce que cela ne sert pas leurs revendications. La violence, estime Badinter « appartient à l’humanité ». Il est impossible de penser à son éradication. Toutefois, il serait préférable qu’elle reste au stade verbal. Parce que la violence, lorsqu’elle devient physique, est souvent source de bestialité.
Elisabeth Badinter a le mérite d’attirer l’attention sur un problème trop longtemps méprisé. Fausse route est avant tout un essai critique du féminisme. Et c’est un véritable plaisir de voir une féministe s’autocritiquer. Cela montre la grandeur et l’humilité intellectuelles du féministe qui est consciente de ce que vivent certains hommes dans leur foyer et sur leurs lieux de travail et du danger que cela représente de l’ignorer.
Edmond BATOSSI
Juriste et philosophe de formation. Chroniqueur littéraire et auteur du recueil de nouvelles La science de mon grand-père.


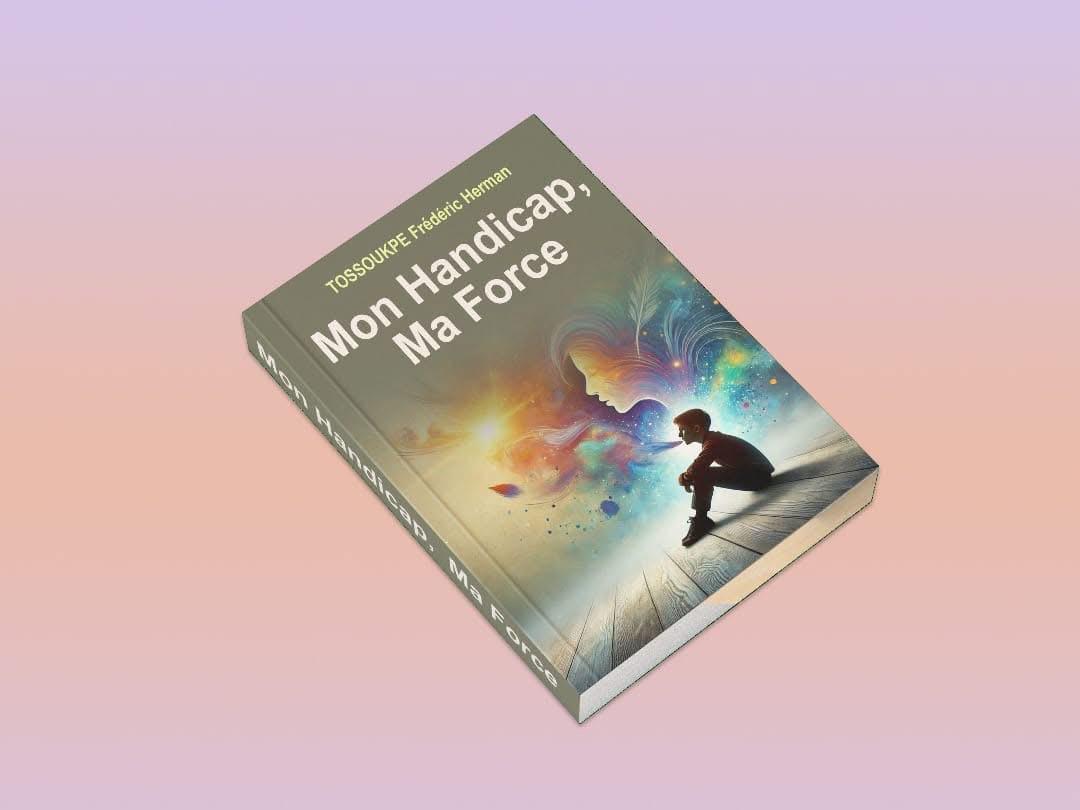
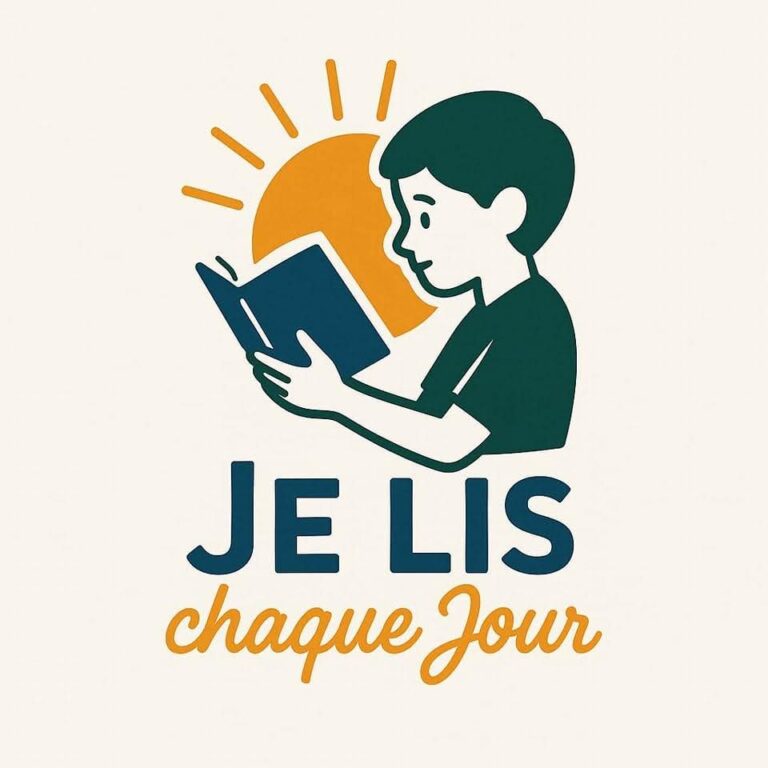
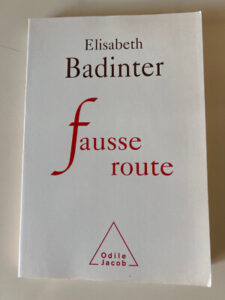
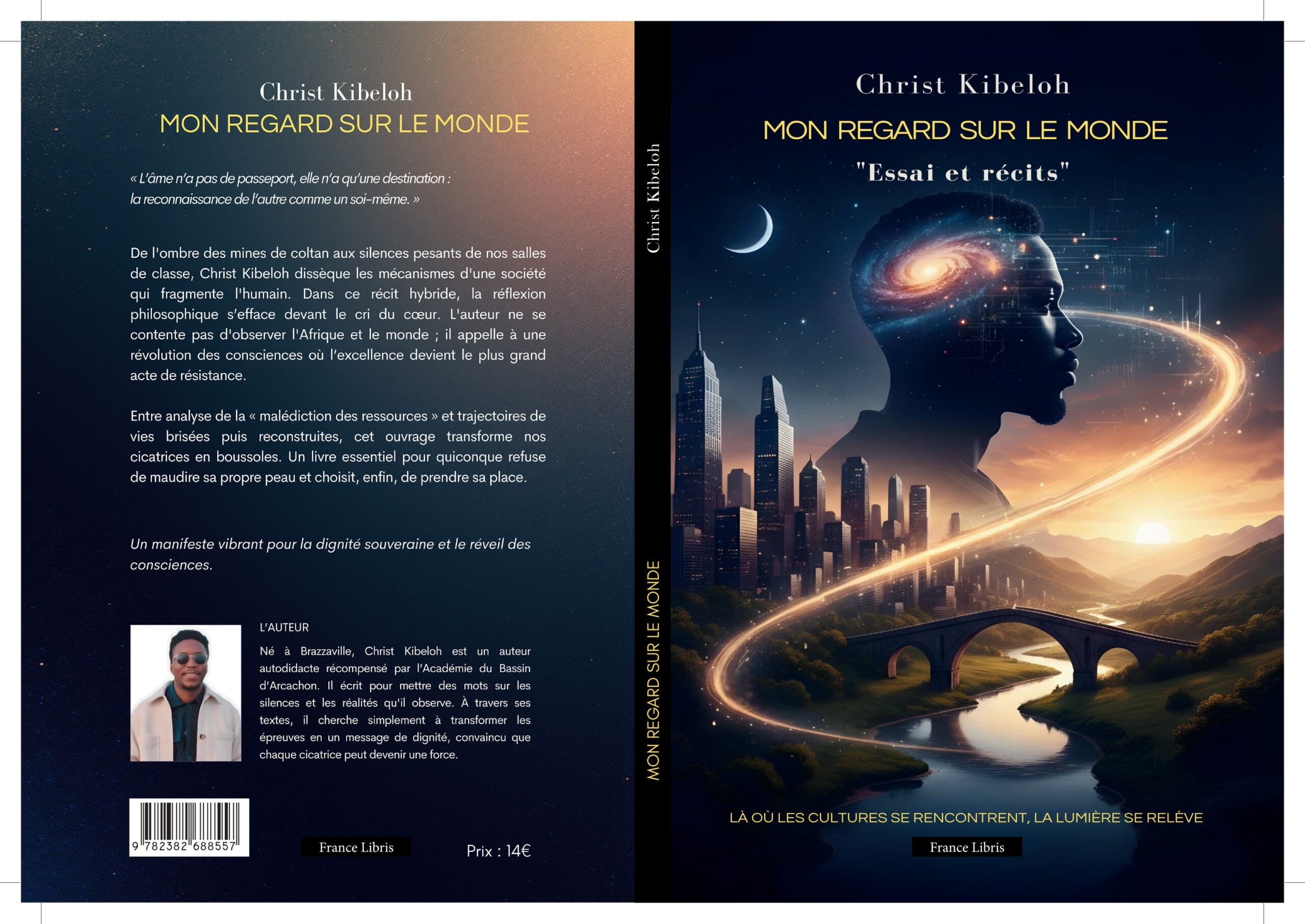





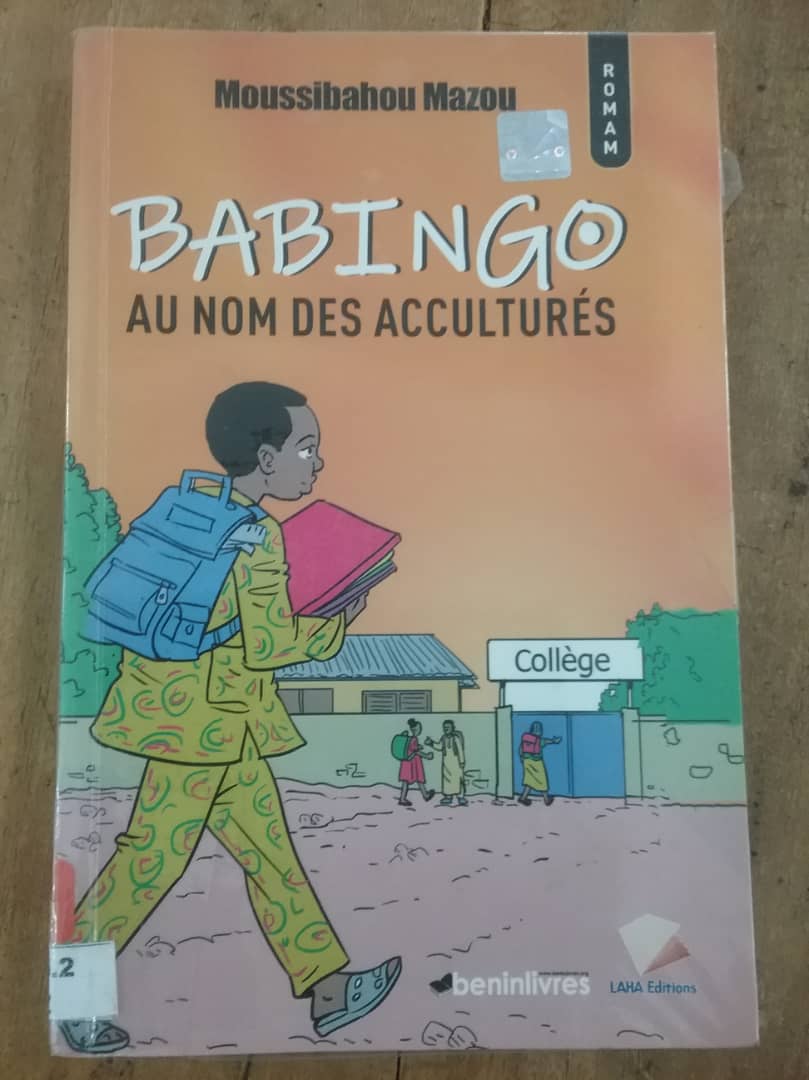


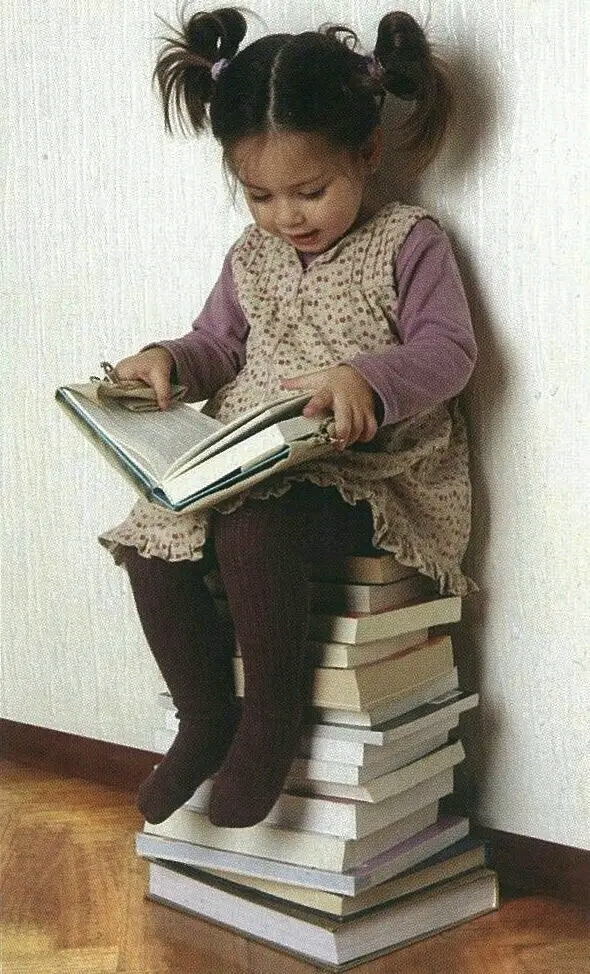

Laisser un commentaire